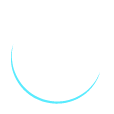La malnutrition (a) est un problème mondial parmi les plus critiques et pourtant l’un des enjeux du développement les moins bien pris en compte. Elle a un coût humain et économique immense, surtout pour les populations pauvres, et plus particulièrement pour les femmes et les enfants. En 2022, 148 millions d’enfants de moins de cinq ans présentaient un retard de croissance (a), c’est-à-dire une taille inférieure à la moyenne pour leur âge. Non seulement ce retard de croissance les empêche de se développer physiquement, mais il laisse aussi présager de nombreuses autres difficultés, notamment des déficits cognitifs et, plus tard, un manque d’opportunités économiques, ce qui se traduit, à l'échelle d’un pays, par une incapacité à accumuler du capital humain.
La prévalence des retards de croissance dans le monde a reculé au cours des trois dernières décennies, pour passer de 40 % en 1990 à 22 % en 2022. Les perturbations infligées par la pandémie de COVID-19 aux systèmes sanitaires et alimentaires ont toutefois effacé des années de progrès sur le front de la lutte contre la dénutrition infantile. On estime que d’ici 2022, 9,3 millions d’enfants supplémentaires auront souffert de malnutrition aiguë et 2,6 millions de plus d’un retard de croissance (a). Les taux mondiaux de malnutrition ont stagné au cours des cinq dernières années ; alors que nous arrivons à mi-parcours de l'échéance des ODD, le monde s’éloigne un peu plus de la trajectoire nécessaire pour diminuer de moitié les taux de retard de croissance d’ici à 2030 (estimations conjointes de la malnutrition infantile pour 2022 [a]). Les deux régions du monde les plus durement touchées sont l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne, cette dernière, plus particulièrement, affichant une augmentation de plus de 2 millions des cas de retard de croissance en 2022 par rapport à 2020, due à la fois à un ralentissement des progrès en la matière et à des taux de fécondité élevés. En outre, ces chiffres ne disent pas tout, car les effets délétères des crises récentes sur la malnutrition chronique ne se sont probablement pas encore pleinement manifestés.
Un retard de croissance chez le jeune enfant peut nuire de manière irréversible au développement cognitif, avec des effets délétères sur l’éducation, le revenu et la productivité à l’âge adulte. Le fléau de la dénutrition a également un coût économique élevé, qui se traduit par des pertes de croissance et de productivité, estimées à 3 000 milliards de dollars par an et représentant entre 3 et 16 % du PIB (voire plus) dans les pays à faible revenu. Selon les estimations d’un réseau mondial d’experts (a) comprenant notamment la Banque mondiale, les pertes de productivité économique liées à l’aggravation de la malnutrition imputable à la pandémie de COVID-19 atteindraient 29 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2022.
Il est néanmoins possible d’éviter une grande partie de ces pertes en réalisant des investissements adéquats dans des interventions dont l’efficacité a été démontrée, et en particulier dans des programmes axés sur une nutrition optimale au cours d’une période cruciale de la vie : les 1 000 premiers jours, entre le début de la grossesse et le deuxième anniversaire de l’enfant.
Et ce alors même qu’une transition nutritionnelle est à l'œuvre dans le monde, entraînant une évolution rapide des systèmes d’alimentation, des environnements et des conditions de vie dans nombre de pays à revenu faible et intermédiaire. Ces changements favorisent la multiplication des cas de surpoids et d’obésité, deux pathologies qui étaient jusqu’ici considérées comme des problèmes spécifiques aux pays riches. De fait, sur les 30 dernières années, les taux de surcharge pondérale ont augmenté plus vite dans les pays à revenu faible et intermédiaire que dans les pays à revenu élevé, et la prévalence de la surcharge pondérale chez les enfants de moins de cinq ans est en hausse dans toutes les régions. En 2020, 38,9 millions d’enfants de moins de cinq ans souffraient de surpoids ou d’obésité. Le coût de ces pathologies en termes de dépenses économiques et sociales est estimé à 2 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale.
Alors que le fléau de la nutrition fait l’objet de la plus grande attention, l'avancée des problèmes de surpoids chez les enfants de moins de cinq ans tend à être négligée. Pourtant, 37 millions d’enfants sont aujourd’hui concernés dans le monde, soit près de 4 millions de plus qu'en 2000, et l'écart se creuse entre la trajectoire actuelle et la cible des ODD visant à faire baisser les taux de surpoids à moins de 3 % d’ici 2030.
Seule l’Europe-Asie centrale semble afficher une tendance positive, tandis que la situation en Amérique latine-Caraïbes, en Asie de l’Est-Pacifique et au Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) exige une action immédiate. La région MENA est la plus touchée : un enfant sur dix est en surpoids ou obèse, et la situation s'est détériorée par rapport aux progrès passés.
Les pays sont donc désormais confrontés au double fardeau de la surcharge pondérale et du retard de croissance. Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale en surpoids vit dans des pays à revenu faible et intermédiaire, et rien n’indique que l’obésité ira en diminuant dans ces pays. En effet, à mesure qu’ils s’enrichissent à la faveur de la croissance économique, une proportion toujours plus grande de leur population pauvre va souffrir de surcharge pondérale ou d’obésité, et, partant, sera de plus en plus vulnérable aux chocs sanitaires et économiques. L'obésité et la dénutrition constituent deux facteurs essentiels pour le développement du capital humain, levier crucial de croissance durable et de réduction de la pauvreté, et pèsent considérablement sur l’indice de capital humain. Il est par conséquent urgent d’assurer l’accès des plus démunis aux informations, aux ressources et aux services nécessaires pour permettre une nutrition optimale.
Le monde est en retard sur les cibles de 2030 en matière de dénutrition et d’obésité et celles-ci ne seront pas atteintes, faute de mesures urgentes et à grande échelle. Le monde doit lutter simultanément contre la sous-alimentation et l’obésité au moyen de stratégies globales : intensification des interventions à fort impact, levier des politiques budgétaires (taxes [a], notamment), mesures de réglementation des marchés ou encore d’étiquetage des aliments néfastes pour la santé (tels que les boissons sucrées), éducation nutritionnelle des consommateurs... De nombreux pays s’y attellent déjà — comme le montre la base de données mondiale sur les taxes sur les boissons sucrées (a) —, mais il reste encore beaucoup à faire pour contribuer à un avenir plus sain et plus durable.
La nutrition est étroitement liée au changement climatique (a) et les femmes, qui ont généralement la charge de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du foyer, sont souvent les premières à pâtir des aléas du climat, de la flambée des prix alimentaires et des pressions inflationnistes. Selon les estimations mondiales les plus récentes, 30 % des femmes en âge de procréer souffraient d’anémie en 2019 (soit un taux supérieur de 7 points de pourcentage au niveau requis pour atteindre la cible de l’ODD d’ici à 2030). Plus alarmant encore, des données plus récentes mais encore incomplètes indiquerait même une hausse des taux d’anémie chez les femmes.
Il est indispensable et urgent de prendre des mesures qui s’attaquent en même temps aux problèmes de la malnutrition et du changement climatique. La mobilisation de financements à grande échelle est essentielle. Avec des budgets nationaux sous tension et des volumes limités d’aide publique au développement, il est crucial de mobiliser des financements innovants (a), y compris auprès du secteur privé. Intensifier les efforts mondiaux en faveur de la nutrition implique non seulement de trouver plus de financements, mais aussi d’assurer une utilisation plus efficace des ressources disponibles au niveau des États, par le biais notamment de l’outil d'aide à la prise de décision Optima Nutrition (a), de l’intégration de l’enjeu de la nutrition dans le budget et de l’examen des dépenses publiques dans ce secteur.
Dernière mise à jour: juin 29, 2023