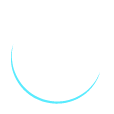L'égalité des sexes est une question d'équité et de justice. C’est aussi un principe du droit international reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Et c'est une condition indispensable au développement.
Les études sont de plus en plus nombreuses qui montrent que l’élimination des obstacles liés au genre stimule la productivité économique, réduit la pauvreté, renforce la cohésion sociale et améliore le bien-être et la prospérité des générations actuelles et futures. La participation et le leadership des femmes améliorent la gestion des ressources naturelles, renforcent la résilience et contribuent à des économies plus compétitives.
Quand les femmes réussissent, les pays et les communautés y gagnent aussi. Le revenu par habitant à long terme pourrait augmenter de quasiment 20 % (a) si les taux d’emploi féminin étaient égaux à ceux des hommes.
Les progrès vers la réalisation de l’Objectif de développement durable n° 5, qui vise à atteindre l’égalité des sexes d’ici à 2030, accusent un retard alarmant.
Il est urgent d’agir contre les violences sexuelles et sexistes (a) : selon des données de 2018, une femme sur trois dans le monde avait été victime de violences physiques ou sexuelles (perpétrées par un partenaire intime ou non). Les violences de genre sont non seulement dévastatrices pour les victimes elles-mêmes, mais elles sont aussi préjudiciables à leurs familles, leurs communautés et la société tout entière. Elles compromettent le bien-être des femmes et leurs moyens de subsistance, et leurs effets se perpétuent souvent de génération en génération.
L’élargissement des opportunités économiques pour les femmes peut être le moteur d’une croissance inclusive. Si l'accès à l’éducation est désormais quasiment égal entre les sexes, le taux d’activité moyen des femmes stagne depuis 1990, à 53 %, contre 80 % pour les hommes (a). Le PIB par habitant à long terme serait supérieur de près de 20 % (a) en moyenne si les écarts d'emploi entre les hommes et les femmes étaient comblés.
Le leadership féminin concourt à l'amélioration durable des résultats économiques, environnementaux et sociaux, ainsi qu’au renforcement des institutions. Des études ont mis en évidence une corrélation entre, d’une part, une plus forte représentation des femmes à des postes décisionnels et, d'autre part, des marges bénéficiaires nettes plus élevées (a) dans les entreprises et des émissions de CO2 plus faibles (a). La part des entreprises à participation majoritaire féminine ou ayant une femme à leur tête est de 25 % seulement.
Dernière mise à jour: oct. 15, 2024