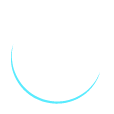Au cours des dernières décennies, le Maroc a réalisé des progrès considérables dans la réduction des taux de mortalité maternelle, néonatale, et infantile, et dans l’amélioration des principaux indicateurs de santé et de nutrition maternelles et infantiles. Toutefois, des écarts importants subsistent entre les zones rurales et urbaines.
Dans les zones rurales, le taux de mortalité maternelle est deux fois et demie plus élevé que dans les zones urbaines (111 contre 45 décès pour 100 000 naissances vivantes). De même, la mortalité infantile y est 37 % plus élevée : 26 décès infantile pour 1 000 naissances vivantes, contre 19 en milieu urbain.1
« Il reste encore beaucoup à faire pour garantir que toutes les femmes, qu'elles soient du village ou des environs, puissent mener une vie digne et accoucher dans des conditions optimales. », a déclaré Najate Nadifi, présidente de l’association Riaaya pour la santé de la femme et de l’enfant. Mme Nadifi est également responsable de la structure communautaire de maternité (Dar Al Oumouma – accueil, hébergement et sensibilisation des femmes enceintes ou venant d’accoucher, ainsi que de leurs nouveau-nés) à Oulad Ougad, un village situé à environ deux heures de route de Marrakech.
« Nous ne voulons plus de différence entre le douar (village en darija marocaine) et la ville ; nous souhaitons avoir accès aux mêmes services. », a déclaré Hanae Afrouh, personne relais communautaire à Oulad Ougad.
Si l’accès aux services essentiels de santé maternelle et infantile s’est considérablement amélioré au Maroc au cours des dernières décennies, il demeure limité dans les zones rurales. Aujourd’hui, 96 % des femmes en milieu urbain accouchent dans un établissement de santé, contre seulement 73,4 % en milieu rural. Le taux de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans atteint 20,5 % dans les zones rurales, contre 10,4 % dans les zones urbaines. Le manque de proximité des centres de santé et les obstacles géographiques expliquent en partie ces inégalités. « Comme nous le savons, il y a des défis à relever, principalement des obstacles géographiques, a déclaré Mme Nadifi. Nous pouvons perdre de nombreuses femmes enceintes simplement à cause de ces délais. »
UN NOUVEAU DISPOSITIF DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DANS LES ZONES RURALES : UNE APPROCHE TRIPARTITE
Dans ce contexte, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), le Ministère de la Santé et de la Protection sociale et l’UNICEF ont piloté un nouveau dispositif de santé communautaire en 2022 afin d’améliorer la santé et la nutrition maternelles et infantiles dans les zones rurales. Le programme pilote a été déployé dans trois régions prioritaires (Beni Mellal-Khenifra, Draa-Tafilalet et Marrakech-Safi), couvrant 14 provinces et 56 centres de santé ruraux.
La particularité de ce nouveau programme est qu’il repose sur la coordination de trois acteurs, impliquant simultanément les Centres de santé ruraux, les Dar Al Oumouma (structure communautaire de maternité) et les personnes relais communautaires.
Les centres de santé accueillent les femmes au moment de l’accouchement et leur fournissent des soins maternels et infantiles après la naissance. Les Dar Al Oumouma (Maison de la maternité en arabe) sont des structures communautaires implantées en milieu rural, qui accompagnent les femmes enceintes et leur offrent un lieu sûr où séjourner avant et après l’accouchement.
« Les Dar Al Oumouma sont des centres ouverts à toutes les femmes, qui peuvent s’y rendre même avant l’accouchement, explique Mme Nadifi. Elles y passent du temps en attendant de donner naissance, dans un environnement sécurisé, »
Les personnes relais communautaires sont mobilisées volontairement et forgent un lien puissant entre la communauté et le système de santé. Elles s’engagent auprès des femmes enceintes du douar et les sensibilisent à l’importance des soins médicaux prénataux.
« Le processus de prise en charge des femmes enceintes commence avant l’accouchement : chaque femme bénéficie de consultations prénatales. Les personnes relais communautaires sont informées qu’elles doivent assister à au moins quatre consultations prénatales, explique Mme Nadifi. Ces personnes relais contactent ensuite l’infirmière en charge, qui supervise à la fois le suivi de la grossesse et l’accouchement. »
Les personnes relais communautaires, choisies par la communauté, sont des habitantes de villages en qui les gens ont confiance. Elles apportent un soutien constant pendant la grossesse, accompagnent les futures mères et les orientent vers les centres de santé au moment de l’accouchement et les mettent en contact avec les Dar Al Oumouma si besoin.
« Je ne fais plus accoucher les femmes à domicile, explique Rachida Fethi, ancienne sage-femme traditionnelle devenue agent de santé. Je leur dis que si elles ont des contractions, elles peuvent frapper à ma porte à tout moment, jour et nuit. Et en cas de besoin, je les encourage à se rendre à l’hôpital pour faire un bilan de santé et vérifier leur taux de sucre et leur tension artérielle. »
Depuis 2022, environ 1 000 personnes relais communautaires ont été recrutées et formées dans les trois régions prioritaires de la phase pilote.
« Mon travail consiste à être en contact avec les habitants du douar qui ne peuvent pas se rendre à l’hôpital. Grâce à la formation que j’ai suivie, on m’a donné les moyens de rester en contact avec les gens, et je me rends chez eux pour le suivi, explique Mme Afrouh. Au début, il y avait inévitablement des obstacles. Les gens ne nous acceptaient pas, disant : ce que vous nous dites n’est pas vrai, nous accouchons à la maison. Mais peu à peu, nous avons commencé à parler, à sensibiliser, et à nous réunir. »
Aujourd’hui, dans sa phase pilote, ce dispositif de santé communautaire a bénéficié à environ 285 000 bénéficiaires (femmes et enfants, entre janvier 2023 et décembre 2024), les orientant vers des services de santé et de nutrition maternelles et infantiles.
SOUTENIR LES EFFORTS DU MAROC POUR UNE MEILLEURE SANTÉ ET NUTRITION MATERNELLES ET INFANTILES
Suite aux résultats encourageants de la phase pilote, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), en coordination avec le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, et avec l’appui technique de la Banque mondiale, a développé une stratégie de mise à l’échelle suite à un diagnostic approfondi de la phase pilote.
Cette stratégie comprend un plan d’action détaillé visant à renforcer le modèle programmatique et le système de gestion des performances du système de santé communautaire, notamment par l’intégration d’outils automatisés de collecte et d’analyse des données, permettant ainsi une prise de décision plus rapide et mieux informée. Elle met également l’accent sur la gouvernance et la durabilité, en adoptant une approche progressive et une priorisation basée sur les indicateurs de développement humain.
« Nous avons moins de problèmes de mortalité, en particulier chez les enfants ; auparavant, nous avions des morts fœtales et beaucoup d’autres complications. Grâce à ce dispositif de santé communautaire, nous avons abordé le problème dans sa globalité et avons pu gérer la situation. L’impact est évident, et la qualité des soins a changé de manière significative, a déclaré Mme Nadifi. Les personnes relais communautaires ont un rôle crucial à jouer, et nous souhaitons sincèrement que ce projet s’étende à toutes les localités rattachées à ce village. »