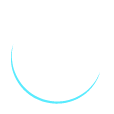Pandémies, catastrophes naturelles (a), variabilité du climat, fluctuations économiques et insécurité de l’emploi : le monde est plus imprévisible que jamais. Ces incertitudes conduisent souvent à envisager de multiples scénarios et génèrent un sentiment diffus d'inquiétude. Comment, dès lors, gérer efficacement ces appréhensions ? Il faut tout d’abord comprendre la nature des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, en distinguant ce sur quoi nous pouvons agir et ce qui échappe à notre contrôle. Car s’il n'est pas possible de prédire quand une catastrophe se produira, il est largement possible de s’y préparer en gardant des fonds en prévision des chocs à venir, en investissant dans des produits d’assurance ou en renforçant les infrastructures et les systèmes.
La Banque mondiale, en partenariat avec la Facilité mondiale pour la prévention des risques de catastrophes et le relèvement (GFDRR) (a), joue un rôle central en aidant les pays et leurs habitants à relever ces défis. Elle s'attache à identifier et évaluer les risques de catastrophe, ce qui permet non seulement de mieux les comprendre, mais aussi de prendre des décisions éclairées sur la manière de se protéger sans dilapider des ressources en prévision d’évènements dont la survenue est improbable. Cette stratégie a considérablement modifié la manière dont la Banque mondiale appréhende la gestion des risques, pour passer d’une posture réactive à une démarche davantage tournée vers la préparation et l’anticipation (a), tout en intégrant progressivement cette dimension dans tout le spectre des activités de développement.
Les enjeux sont cependant de plus en plus lourds à mesure que s'intensifie le changement climatique. Les catastrophes naturelles frappent aveuglément, sans distinction d’âge ni de statut socioéconomique. Pour autant, elles ne nous affectent pas tous de la même façon : ceux qui sont moins préparés ou plus fragiles — comme les femmes et les personnes handicapées (a) — en paient le plus lourd tribut. Plus généralement, les pays soutenus par l’Association internationale de développement (IDA), la branche de la Banque mondiale qui vient en aide aux pays les plus pauvres, sont très vulnérables aux effets du changement climatique et à l’intensification des risques de catastrophe, et sont de surcroît souvent en proie à des situations de fragilité, conflit ou violence (a).
C’est pourquoi la Banque mondiale a mis en place de nouveaux instruments destinés à aider les pays en développement à mieux faire face aux crises, dans le cadre notamment de sa panoplie élargie d’outils de crise et du Mécanisme de réponse aux crises de l’IDA. Elle s’emploie également à accroître les ressources consacrées aux financements climatiques (a) et mise sur l’apport des connaissances pour influer sur le programme de développement mondial. Il est par ailleurs crucial d’accompagner ces efforts par la promotion de partenariats avec d'autres institutions de développement, des entreprises technologiques, le secteur privé, des groupes de la société civile et le monde universitaire. En constituant un vaste réseau d’expertise et de ressources en faveur d’un renforcement général de la résilience, ces collaborations permettent de faire en sorte que les communautés les plus vulnérables puissent bénéficier du soutien nécessaire pour faire face, avec confiance, à un avenir de plus en plus incertain.
Dernière mise à jour: avr. 29,2024