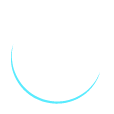Bonjour.
Monsieur le Vice-Premier ministre Correia, merci de présider cette séance plénière.
Kristalina, je suis heureux de célébrer ce partenariat à vos côtés.
Les récents événements en Syrie et à Gaza nous donnent des raisons d’espérer que la paix est possible partout où il y a des conflits – RDC, Soudan, Ukraine, Yémen, pour ne citer que ces pays-là.
Autant nous aspirons à la paix, autant nous devons nous y préparer.
Dans cette optique, nous avons réuni des groupes d’experts régionaux issus des secteurs public et privé pour planifier la reconstruction à Gaza et en Ukraine. Le groupe de Gaza coordonne dès à présent ses activités avec des partenaires œuvrant dans la région.
La reconstruction est un pan essentiel de notre mission.
Un service que nous sommes prêts à fournir dans toute la mesure de nos moyens quand et là où le besoin se fait sentir.
Dans le même temps, en tant qu’institution de développement, nous sommes tout aussi attachés à la prévention des conflits.
Car en plus de reconstruire ce qui a été détruit, nous devons nous employer à créer les conditions propices aux opportunités et à la stabilité.
C’est ce qui anime nos actions et nos décisions aujourd’hui.
Nous vivons l’une des plus grandes transformations démographiques de l’histoire de l’humanité.
D’ici à 2050, plus de 85 % de la population mondiale vivra dans les pays dits « en développement » aujourd’hui.
Rien qu’au cours des 10 à 15 prochaines années, 1,2 milliard de jeunes entreront sur le marché du travail, pour environ 400 millions d’emplois seulement. Le déficit est abyssal.
Pour bien saisir l’urgence de la situation, disons simplement ceci :
Au cours des dix prochaines années, chaque seconde verra arriver quatre jeunes sur le marché du travail dans le monde.
Ainsi, le temps pour moi de prononcer ce discours, des dizaines de milliers de personnes auront franchi ce grand pas, pleines d’ambition, pressées de faire leurs preuves.
C’est en Afrique que la croissance démographique est la plus rapide, et une personne sur quatre y vivra en 2050. D’ici là, selon les estimations :
La Zambie comptera 700 000 personnes de plus chaque année.
La population du Mozambique doublera.
Tandis que la population du Nigeria augmentera fortement d’environ 130 millions de personnes, faisant incontestablement du pays l’une des nations les plus peuplées du monde.
Ces jeunes personnes, débordantes d’énergie et d’idées, définiront le prochain siècle.
Des investissements judicieux — axés non pas sur les besoins, mais sur les opportunités — nous permettraient de libérer un puissant moteur de croissance mondiale.
Sans un effort résolu, leur optimisme pourrait se muer en désespoir, ouvrant la voie à l’instabilité, à des troubles et à des migrations massives, dont les répercussions toucheront toutes les régions et toutes les économies.
C’est pourquoi l’emploi doit être au cœur de toute stratégie de développement, d’économie ou de sécurité nationale.
Qu’entendons-nous par emploi ?
Le fait de travailler pour une entreprise et d’y gravir les échelons de la hiérarchie...
ou d’être employé dans une petite entreprise...
Mais peut-être aussi le fait de créer sa propre entreprise.
Un emploi, c’est bien plus qu’un chèque à la fin du mois. C’est ce qui permet aux femmes comme aux hommes de réaliser leurs aspirations.
C’est une raison d’être. La dignité.
Le fondement de la stabilité des familles, le ciment qui soude ensemble les pans de toute société.
C’est le chemin le plus droit vers la stabilité, et c’est l’avancée la plus difficile à défaire.
C’est pourquoi nous avons redéfini notre action…
…notre manière de la mesurer…et la manière dont la menons— autour de cette réalité.
Au cours des deux dernières années, nous nous sommes employés à rendre nos interventions plus rapides, plus simples et plus concrètes.
Le délai moyen d’approbation des projets est passé de 19 à 12 mois. Certains projets sont désormais approuvés en moins de 30 jours.
Nous avons consolidé la direction dans 40 de nos bureaux de pays, offrant ainsi à nos clients un point de contact unique. D’ici juin de l’année prochaine, cette structure aura été étendue à tous les pays.
Notre Banque de connaissances est mise en commun à l’échelle du Groupe, dans le but principalement de reproduire les solutions à grande échelle.
Des services comme le budget, les ressources humaines, la passation des marchés et l’immobilier sont unifiés.
Au lieu de 153 indicateurs internes, nous avons une fiche de performance institutionnelle comportant 22 indicateurs de résultats.
De nouveaux instruments et l’optimisation des ressources nous ont permis d’accroître notre capacité financière d’environ 100 milliards de dollars.
La plateforme de cofinancement des BMD compte désormais une réserve de 175 projets. Au total, 22 de ces projets sont entièrement financés, à hauteur de 23 milliards de dollars.
Nous avons conclu un accord de délégation réciproque avec la Banque asiatique de développement, réduisant ainsi les doubles emplois pour les clients. Nous travaillons à en établir d’autres avec les BMD partenaires.
Et nous élaborons une stratégie IFC 2030 visant à renforcer la mobilisation des capitaux privés.
Ces réformes représentent le fondement.
La mission, c’est l’emploi.
La plupart des emplois — près de 90 % — proviennent en fin de compte du secteur privé. Mais ils n’y commencent pas tous.
L’évolution des pays s’inscrit dans un continuum :
au départ, le secteur public est le moteur de la création d’emplois ;
au fil du temps, les capitaux privés et l’entrepreneuriat prennent le relais.
Mais le secteur privé, grand ou petit, local ou mondial, ne peut réussir seul.
Les entrepreneurs ont besoin de conditions favorables pour démarrer, se développer et embaucher.
Ces conditions n’apparaissent pas toutes seules.
C’est là qu’intervient le Groupe de la Banque mondiale, avec sa stratégie singulière à trois piliers :
Premièrement, les gouvernements sont à l’œuvre — souvent avec la contribution du secteur privé — construisant les infrastructures humaines et physiques qui suscitent les opportunités : routes, ports, électricité, éducation, numérisation et soins de santé. Nos institutions axées sur le secteur public — la BIRD et l’IDA — financent ces investissements et aident les pays à utiliser efficacement les ressources et à établir des partenariats public-privé.
Deuxièmement, un cadre des affaires reposant sur une réglementation claire, des règles du jeu équitables et une gestion saine de l’économie doit être mis en place. Il est question ici de sécurisation des droits fonciers, de prévisibilité du système fiscal, de transparence des institutions, de gestion responsable de la dette et de politiques de change. Nous accompagnons ces réformes aux côtés du FMI par l’intermédiaire de notre Banque de connaissances, en recourant à des outils stratégiques et au financement basé sur les résultats.
Troisièmement, une fois que les bases sont posées, nous aidons le secteur privé à se développer et compensons la prise de risque par des capitaux, fonds propres, garanties et l’assurance contre les risques politiques que fournissent IFC et la MIGA — sous le regard du CIRDI.
C’est par cette boucle — fondement, politiques publiques, capitaux — que notre ambition se traduit par des emplois. Que nous transformons des possibilités en chèques de paie.
Nous avons recensé cinq secteurs porteurs pour la création d’emplois : les infrastructures et l’énergie, l’agro-industrie, les soins de santé, le tourisme et l’industrie manufacturière à valeur ajoutée, y compris les minerais critiques.
Ces secteurs ne sont pas tributaires de l’aide. Ce sont des moteurs de croissance, capables de créer des emplois pertinents au niveau local sans délocaliser ceux des économies développées.
Et ils contribuent à bâtir la classe moyenne qui nourrira la demande mondiale de demain, notamment de biens et services en provenance des marchés développés.
Au cours des deux dernières années, nous avons lancé une série d’initiatives stratégiques dans bon nombre de ces secteurs. Loin d’être cloisonnées, ces initiatives se renforcent mutuellement et font appel à toute la panoplie du Groupe de la Banque mondiale, aux côtés de partenaires. Parce que nous devrons travailler ensemble pour obtenir des résultats à grande échelle.
Notre stratégie en matière d’électricité privilégie l’accessibilité physique, l’accessibilité financière et la fiabilité, parallèlement à la gestion responsable des émissions. Elle étaye Mission 300, notre initiative pour apporter l’électricité à 300 millions d’Africains d’ici à 2030. Les pays ont la latitude de choisir ce qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur contexte, moderniser les réseaux ou installer des solutions solaires, éoliennes, hydroélectriques, gazières et géothermiques. Pour la première fois depuis des décennies, nous avons aussi entrepris – en partenariat avec l’AIEA – d’offrir un soutien pour des solutions utilisant le nucléaire. L’objectif est d’avoir suffisamment d’énergie pour stimuler la productivité des personnes et des entreprises.
Nous nous sommes fixé pour objectif d’aider à fournir des soins de santé à 1,5 milliard de personnes. En décembre, nous réunirons des gouvernements, des investisseurs et des innovateurs lors d’un sommet à Tokyo pour accélérer les actions dans ce domaine. L’Indonésie montre déjà la voie en s’engageant à offrir chaque année à chaque citoyen des soins primaires le jour de son anniversaire, une approche qui pourrait révolutionner les soins de santé pour 300 millions de personnes.
Avec AgriConnect, nous voulons aider les petits exploitants agricoles à passer d’une activité de subsistance à une production excédentaire. Grâce à un écosystème de coopératives intégrant les financements pour les agriculteurs et les PME, reliant les producteurs aux marchés et exploitant des outils numériques comme l’IA à petite échelle. Cette initiative donne corps à notre engagement de doubler notre financement pour le porter à 9 milliards de dollars par an et de mobiliser 5 milliards de dollars supplémentaires.
Nous sommes également en train de finaliser une stratégie sur les minéraux et l’extraction minière destinée à aider les pays à passer de l’extraction de matières premières à la transformation et la fabrication régionale, afin de retenir sur place plus de valeur et plus d’emplois. Nous espérons la rendre publique dans les mois à venir.
Concrètement, comment réalisons-nous tout ça ?
Nous commençons par un cadre de partenariat-pays unique pour l’ensemble du Groupe de la Banque mondiale, préparé conjointement par les responsables nationaux et nos experts thématiques.
Chaque cadre est un plan stratégique à long terme qui réunit les capacités de l’IDA, de la BIRD, d’IFC, de la MIGA et du CIRDI autour d’un ensemble de priorités bien ciblées, et il est adapté aux besoins et aux ambitions de chaque pays.
Pour un pays, il peut s’agir de chaînes de valeur minérales complètes... pour un autre, d’activités touristiques ancrées dans la nature et la culture... peut-être de systèmes de santé plus solides qui guérissent et emploient... ou alors d’écosystèmes agro-industriels qui améliorent le sort des petits agriculteurs.
Le parcours est certes personnalisé, mais les fondements sont les mêmes :
construire les infrastructures,
fixer des règles claires et prévisibles,
et faciliter l’investissement privé.
Pour atteindre l’échelle voulue — et libérer notre bilan pour des défis plus complexes — nous devons débloquer tout le potentiel du secteur privé.
C’est pourquoi nous levons les barrières à l’investissement et créons les conditions propices à l’apport de capitaux privés au profit du développement.
Nous mettons en œuvre la feuille de route fournie par le Laboratoire de l’investissement privé, en déployant des outils et des solutions pratiques dans l’ensemble de l’institution :
La clarté réglementaire — d’abord appliquée dans le cadre de Mission 300 et maintenant sur d’autres initiatives ; notre Banque de connaissances remaniée poursuivra le travail.
Les garanties, désormais gérées de manière centralisée par la MIGA et avec succès jusqu’ici, l’objectif étant de tripler les activités d’ici à 2030.
Les solutions en matière de change — avec le FMI, nous développons des marchés financiers locaux dans 20 pays. IFC a quant à elle réalisé un tiers de ses prêts en monnaie nationale, son objectif étant d’atteindre 40 % d’ici à 2030.
Les participations de second rang — nous avons lancé le Frontier Opportunities Fund, dont les fonds proviennent du revenu net d’IFC, mais il a besoin de contributions supplémentaires de la part d’organisations philanthropiques et d’États.
Et, sans doute l’initiative la plus transformatrice, un modèle d’octroi puis de cession, qui permet de regrouper les actifs en produits d’investissement pour attirer des capitaux institutionnels à grande échelle dans les marchés émergents. Une initiative pilotée par l’ancien PDG de S&P, Doug Peterson.
Il y a quelques semaines à peine, nous avons finalisé notre première transaction, regroupant 510 millions de dollars de prêts d’IFC dans des titres notés. La demande était importante. Reste le problème de l’offre : nous avons donc entrepris de constituer une solide réserve à long terme dans l’ensemble de la Banque. Et nous prévoyons de collaborer avec d’autres.
Chaque pas réduit les risques, renforce la confiance et contribue à tendre la main aux capitaux privés.
Mais les capitaux ne viendront pas sans une base solide dès le départ.
C’est pourquoi nous nous attachons à faire en sorte que le développement soit résilient, responsable sur le plan budgétaire, ancré dans la confiance et pérenne : un développement intelligent.
De nombreux pays essaient aujourd’hui de se développer, de créer des emplois et de sortir leur population de la pauvreté, tout en essuyant des sécheresses, des tempêtes et des inondations — souvent sur une base budgétaire précaire, fragilisés par la dette, affaiblis par la corruption ou privés des ressources nécessaires pour avancer.
Un développement intelligent, c’est renforcer la résilience physique et raffermir les institutions.
C’est ce que demandent nos clients. Et cette exigence est en train de redéfinir notre travail.
Les chiffres en disent long. L’année dernière, 48 % de nos financements ont été classés comme produisant des avantages climatiques annexes selon la méthodologie commune des BMD, bien au-delà de nos attentes.
La résilience représentait 43 % du portefeuille du secteur public, contre un tiers il y a seulement deux ans.
Permettez-moi d’expliquer quelque peu ce concept d’avantages connexes et pourquoi nous y sommes poussés par les clients.
Lorsque nous construisons une route qui relie un fabricant de produits pharmaceutiques à un marché, et que la qualité est telle qu’elle peut résister aux inondations et n’a pas besoin d’être reconstruite.
Cela est comptabilisé.
Lorsque nous construisons une école ou un incubateur de talents et les recouvrons d’une toiture aux propriétés isolantes et réfléchissantes, de sorte que la chaleur ou le froid extrêmes ne nuisent pas à l’apprentissage.
Cela est comptabilisé.
Lorsque nous aidons les agriculteurs à accéder à l’irrigation au goutte-à-goutte et à des semences résistantes à la sécheresse qui augmentent les rendements agricoles et les bénéfices et prémunissent contre les périodes sèches.
Cela est comptabilisé.
Et si nous construisons un corridor de transport de marchandises par train plutôt que par camion, qui transporte le fret plus rapidement et à moindre coût.
Cela est comptabilisé.
Un développement intelligent est un développement pérenne.
La même exigence nous fait repenser nos interventions en matière d’institutions et de finances publiques. De plus en plus de pays demandent de l’aide pour renforcer leurs systèmes de base, et nous innovons :
En lançant une nouvelle série d’examens des finances publiques pour aider les gouvernements à réorienter les dépenses vers des priorités à fort impact : 14 évaluations ont été achevées et 22 autres sont attendues prochainement.
En aidant à gérer les risques de liquidité avant qu’ils ne s’aggravent : les apports nets de l’IDA ont atteint 21 milliards de dollars durant l’exercice écoulé, contre 12 milliards de dollars il y a trois ans.
En déployant des outils de conversion de la dette en projets de développement pour alléger le fardeau de la dette et libérer des ressources. Nous avons commencé avec la Côte d’Ivoire et neuf autres opérations similaires sont en préparation. Nous avons soif d’en faire plus.
Et nous collaborons étroitement avec des partenaires comme le FMI pour accélérer la restructuration de la dette dans le Cadre commun du G20, tout en avançant sur les réformes des recettes intérieures, en augmentant les financements et en soutenant la gestion du passif. Nous nous employons parallèlement à améliorer la transparence en étendant le Système de notification des pays débiteurs à tous les pays du G20, afin d’éclairer davantage toutes les parties et de renforcer la confiance de tous.
Et nous répondons au désir croissant d’outils qui renforcent la confiance :
En aidant les pouvoirs publics à lutter contre la corruption grâce à des outils fondés sur les données, à des identifiants numériques liés aux actifs, à une meilleure détection des fraudes et à l’intelligence artificielle qui relie les données fiscales, immobilières et d’identification. Au cours des dix dernières années, nous avons accompagné 120 gouvernements dans cette démarche et travaillons actuellement avec 26 autres pour combattre la corruption et les flux financiers illicites.
Et parce que même les meilleurs systèmes ont besoin de gestionnaires compétents, notre Académie du savoir outille les fonctionnaires pour qu’ils puissent piloter les réformes. Plus de 200 hauts fonctionnaires ont déjà été formés, et six nouvelles filières seront bientôt lancées.
Nous entrevoyons déjà ce qu’il est possible d’accomplir.
En tout juste deux ans, nos financements annuels sont passés de 107 milliards à 119 milliards de dollars.
Les capitaux privés mobilisés sont passés de 47 milliards à 67 milliards de dollars.
Le montant total des engagements, y compris la MCP, a atteint 186 milliards de dollars.
Et nous avons levé 79 milliards de dollars supplémentaires auprès d’investisseurs privés par le biais d’émissions obligataires.
Des actions de cette échelle produisent des résultats concrets :
Depuis le lancement de la nouvelle Fiche de performance du Groupe de la Banque mondiale en 2024, nous avons permis à :
20 millions d’agriculteurs d’avoir accès aux technologies, aux intrants et aux marchés.
60 millions de personnes de bénéficier de l’électricité
70 millions de personnes d’être éduquées ou formées
Et à 300 millions de personnes de bénéficier de services de santé et de nutrition de qualité
Ces chiffres, certes impressionnants, rendent compte d’actions plus ciblées et d’un nouvel état d’esprit.
Qui appréhende le développement non pas comme de la charité, mais comme une stratégie. Et voit dans l’emploi non pas un contrecoup, mais le résultat d’un développement bien mené.
Car lorsque nous nous concentrons sur l’emploi, nous ne nous détournons pas des soins de santé, des infrastructures, de l’éducation ou de l’énergie ; nous intensifions notre action dans tous ces domaines.
Un emploi, c’est ce qui se trouve au bout d’une école qui mène à une compétence, d’une route qui mène à un marché, d’une clinique qui permet à une personne d’être suffisamment en bonne santé pour travailler, de l’énergie qui alimente une entreprise.
C’est ainsi que nos efforts convergent. Que nous transformons l’investissement en impact.
Et c’est ainsi que nous apportons aux gens ce qu’ils veulent le plus, ce dont ils ont le plus besoin et ce qu’ils méritent le plus :
Un emploi.
Une chance.
Un avenir.
Et... la dignité.